Appartient au dossier : Art et crise : le New Deal
Le New Deal et l’architecture
Pour la première et seule fois dans l’histoire des Etats-Unis, c’est l’Etat fédéral le promoteur et l’exécutant de grands travaux publics d’infrastructure, d’édifices institutionnels en général et de logements sociaux en particulier.
« Vous qui avez imaginé et osé créer ce qu’il n’est pas déplacé de nommer le gratte-ciel, est-il trop vous demander que de porter votre regard plus bas pour vous représenter l’image d’une ville d’appartements où l’air, la lumière et le soleil seraient le bien de tous ? Si vous réalisez ce rêve, ce serait là pour vous la découverte du plus gratifiant des sentiments, de la conscience que vous auriez fait beaucoup pour rendre la vie plus plaisante et plus gaie pour des millions de vos concitoyens. » Franklin D. Roosevelt
Cette lettre du Président adressée au congrès de l’ « American Institute of Architects » en mai 1936, reflète la position paradoxale de l’architecture pendant la période du New Deal : entre retour aux traditions de l’architecture vernaculaire et naissance du « style international ». Cette position s’inscrit dans la philosophie générale du New Deal : donner du travail aux Américains tout en bâtissant l’identité du pays.

Les plus gigantesques travaux publics de l’histoire américaine
 600 aéroports, 110 000 écoles, gares, bureaux de poste ont été bâtis ou restaurés, 100 000 ponts ont vu le jour ainsi que le fameux barrage Grand Coulee sur la Columbia, construit pour produire de l’électricité bon marché mais aussi à l’origine de déplacements de populations, dont 3 000 Amérindiens. |
Le logement social est au centre de la réflexion
 Dans les années 30, un tiers de la population vit dans des slum, héritage du 19e siècle pour accueillir les vagues d’immigrants. En 1932, l’exposition organisée par le Musée d’Art Moderne de New York, intitulée Modern architecture – International Exhibition est déterminante pour informer le public américain des nouvelles tendances de l’architecture. Elle tourne entre onze villes des Etats-Unis pendant six ans. Une partie du catalogue de l’exposition est entièrement consacré au logement. Lewis Mumford y défend un habitat conçu comme un service public et non comme une source de profit, qui doit permettre une vie associative intense fondée sur des équipements collectifs. Néanmoins, la politique américaine de l’habitat collectif trouve sa limite dans la dérive vers la ségrégation communautaire. Cette exposition au MoMA consacre aussi la naissance de l’architecture moderne, avec le « style international ». |
La naissance du Style International
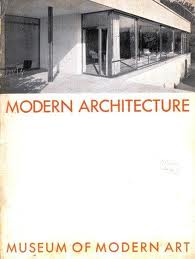 L’expression est utilisée pour la première fois par le critique américain Henry-Russell Hitchcock dans l’intention de classifier l’architecture moderne des années 20 et 30. Ses principes de base sont : le dépassement de l’imitation des styles historiques, l’allégement des volumes grâce à l’utilisation de minces piliers en béton ou en métal, des volumes simples et réguliers, des surfaces lisses, un plan libre. Animés par leurs convictions sociales et leur foi dans la production de masse, les architectes internationalistes conçoivent des projets pouvant être réalisés n’importe où dans le monde. L’évolution des transports de marchandises par le rail permettent de se libérer des contraintes géographiques, tandis que les nouvelles techniques de construction offrent la possibilité de construire pour tous. |
Les architectes européens ont-ils influencé l’architecture américaine pendant le New Deal ?
 Richard Neutra, architecture viennois, s’établit à Los Angeles en 1925 : il contribue à populariser le modernisme en Californie. Par contre, les architectes du Bauhaus (Walter Gropius, Marcel Breuer, Mies Van der Rohe), émigrés aux Etats-Unis au fur et à mesure de la progression du fascisme en Europe ne s’illustrent dans la construction qu’à la fin des années 30. Leur rôle se limitera à l’enseignement, néanmoins déterminant pour la décennie à venir. Il permettra aux Etats-Unis de l’après-guerre d’inverser le sens des influences vers l’Europe, désormais pionniers dans la modernité. Il faut aussi noter que les programmes d’architectures initiés par le gouvernement privilégient un travail d’équipe plutôt que celui d’un individu. |
Alors quel nom retenir ?

Sans nul doute celui de Frank Lloyd Wright, reconnu comme le plus grand architecte américain et l’un des plus féconds du 20e siècle. Pendant les années du New Deal, Franck Lloyd Wright construit la fameuse maison sur la cascade à Bear Run, symbole d’une architecture inscrite dans son environnement, associée au concept d’ « architecture organique ».
Il élabore aussi son projet théorique de Broadacre City, destiné à être un modèle urbanistique alternatif à la traditionnelle métropole américaine. Wright défend l’idée de conception et de réalisation collective. Son adhésion aux idées du New Deal lui vaudra dans les années du maccarthysme une inscription sur la « liste noire » des 15 000 personnes à mettre à l’écart, aux côtés de George Gershwin, Leonard Bernstein, Ernest Hemingway, Arthur Miller…
La commande architecturale est-elle venue uniquement de l’Etat ?

Principalement : entre 1933 et 1939, la PWA fait réaliser 70% des nouvelles écoles, 65% des palais de justice, des mairies et des usines, 35% des hôpitaux.
Le Rockefeller Center fait partie des exceptions. Commencé avant la Grande Dépression, terminé en 1939, il est financé par la famille Rockefeller, magnat du pétrole. Cet immense complexe de style Art déco constitue un haut lieu de l’art moderne : il est parmi les derniers projets majeurs aux Etats-Unis à intégrer un programme d’art public. Pas moins de trente-neuf artistes internationaux travaillèrent à la décoration du complexe. Une fresque est commandée à l’artiste mexicain Diego Rivera. Il y peint le portrait de Lénine, que Rockefeller lui demande d’enlever. Devant son refus, la fresque sera recouverte puis détruite.
Quel est l’apport du New Deal à l’architecture américaine ?
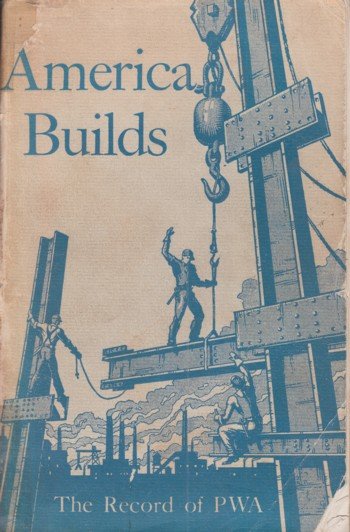
Le New Deal ne remet pas vraiment en question l’architecture : le mouvement moderne était déjà en marche depuis le début du siècle. C’est du côté des idées plus que des formes qu’il convient de chercher les influences et la postérité de la philosophie du New Deal, notamment l’équilibre entre l’autonomie individuelle et la cohésion sociale.
Le New Deal apporte une nouvelle vision du rôle de l’architecture en tant qu’activité sociale et politique, destinée non plus à satisfaire les besoins de prestige d’une minorité, mais les besoins fondamentaux de ceux « d’en bas » auxquels Roosevelt avait, en 1933, promis une « Nouvelle Donne ».
Publié le 22/03/2013
Sélection de références
Américanisme et modernité : l'idéal américain dans l'architecture
sous la direction de Jean-Louis Cohen et Hubert Damish
Flammarion ; EHESS, 1992
Voir Les racines européennes de la culture du New Deal, Anatole Kopp, pp 361-374
À la Bpi, niveau 3, 724-7 COH
L'avenir de l'architecture
Wright, Frank Lloyd
Ed. du Linteau, 2003
Frank Lloyd Wright décrit son projet de bureaux pour la Johnson Wax (1936-1939) : « Si vous leur permettez d’être fiers de ce qui les entoure et heureux d’être où il sont, si vous leur donnez de la dignité et de la fierté dans leur cadre de travail, cela se révélera du meilleur effet pour la production. Un cadre salubre dont les travailleurs puissent tirer orgueil est rentable ».
À la Bpi, niveau 3, 70″19″ WRIG 1
Le style international : le modernisme dans l'architecture de 1925 à 1965
Khan, Hasan-Uddin
Taschen, 2001
Un panorama de la période 1925-1965, une ère d’optimiste architectural aux ambitions sociales.
À la Bpi, niveau 3, 724-7 KHA
Le style international
Hitchcock, Henry-Russell ; Johnson, Philip
Parentheses, 2002
C’est quelque temps après la célèbre exposition du Museum of Modern Art de New York «Modern Architecture : International Exhibition», qu’a paru en 1932 le livre de Henry-Russell Hitchcock et Philip Johnson : The International Style : Architecture since 1922 qui en constitue le prolongement durable. Il s’agissait de faire connaître au public américain les développements récents de l’avant-garde notamment européenne. Approuvé ou contesté, ce livre demeure un des textes majeurs pour comprendre l’architecture du 20e siècle.
À la Bpi, niveau 3, 724-7 RUS
Les années trente : l'architecture et les arts de l'espace entre industrie et nostalgie
sous la direction de Jean-Louis Cohen
Ed. du Patrimoine, 1997
Voir L’architecture du New Deal et l’idéal communautaire, Gwendolyn Wright, pp. 144-153
À la Bpi, niveau 3, 724.407 COH
Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires