American Pandemonium, de Benjamin Hoffmann
Dans son quatrième roman, Benjamin Hoffmann imagine une apocalypse digne des films catastrophe les plus spectaculaires de l’industrie hollywoodienne, et l’utilise comme point de départ pour construire une fable étonnante qui bouscule notre perception de la réalité et de son traitement médiatique.
Ça ne rate jamais : qu’il s’agisse de débarquements d’extraterrestres, de chutes d’astéroïdes ou de virus mutants, New-York est toujours en première ligne. Le nombre de fois où la ville a été rasée dans des œuvres de fiction est incalculable, et voilà que ça recommence dans le nouveau roman de Benjamin Hoffmann :
Je gravis les rochers qui donnaient sur midtown : des centaines de bombes s’abattaient sur New-York. Elles explosaient au sommet des gratte-ciel, soufflant les vitres et brisant les antennes colossales, elles explosaient dans les rues, massacrant les passants. Chaque appareil vomissait sa cargaison qui creusait des sillons de ruines ; une fois délesté, il se dirigeait vers un secteur encore intact pour s’y écraser.
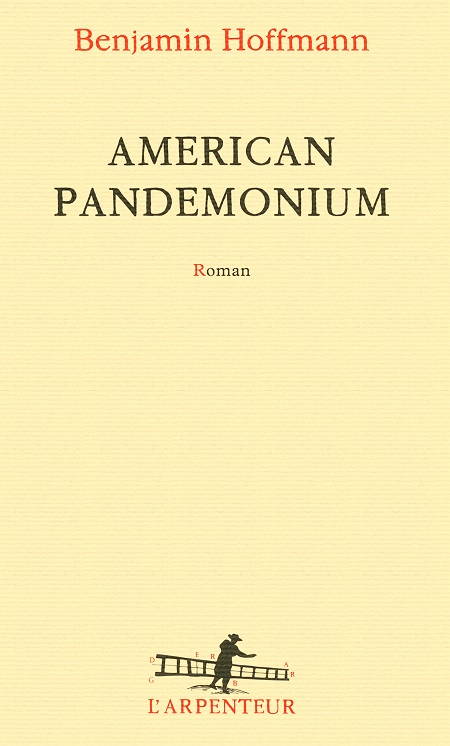
Après la catastrophe, de petits groupes de survivants s’organisent tant bien que mal pour faire renaître un minimum d’ordre social. Mais malgré quelques bonnes volontés, la loi du plus fort s’impose et la violence devient la seule règle. Marc et Colin, qui tentent d’écrire au fur et à mesure le récit de leur aventure, partent à la recherche du frère du premier, qu’ils pensent trouver à Yale, mais qu’ils devront poursuivre jusqu’à Chicago. Sur leur chemin, ils croisent divers groupes humains, qui mettent en place des stratégies variées pour survivre – de la tentative de conserver une répartition des pouvoirs similaire à celle qui prévalait dans l’Amérique fédérale pour certains, à la construction du “Behemoth”, une machine vouée à répandre la désolation, pour d’autres.
Les références auxquelles renvoie American Pandemonium sont innombrables. Des références à l’Histoire d’abord, la grande catastrophe prenant tour à tour et selon les villes frappées les visages du 11 septembre, d’une attaque nucléaire et de l’attentat au gaz sarin du métro de Tokyo en 1995. Mais c’est bien sûr le mille-feuilles des références à la littérature post-apocalyptique qui s’impose : l’errance des personnages rappelle la Route de Cormac McCarthy, leur tentative de reconstruire Malevil de Robert Merle, et les guerres internes l’Aveuglement de José Saramago – entre cent autres.
Au-delà, on ne peut s’empêcher de penser au cinéma et même au jeu vidéo, Benjamin Hoffmann semblant emprunter certains outils narratifs à des titres comme Fallout ou The Last of Us, les mutants et les zombies en moins.
On peut penser, surtout, à un texte plus méconnu mais qui tire de la catastrophe la même possibilité de subversion : Dies Irae de Leonid Andreiev, où un séisme titanesque permet à des prisonniers de retrouver leur liberté parmi les ruines de notre civilisation. Comme chez Andreiev, on trouve chez Hoffmann cette notion de prise de pouvoir par les damnés de l’ancienne société, cette impression aussi que l’humanité peut repartir sur de nouvelles bases, mais que bien vite le Mal peut reprendre le dessus.
Toutes ces passerelles vers d’autres œuvres trouvent cependant leur limite lorsque les survivants New-Yorkais que nous suivons tout au long du roman découvrent, une fois passé Chicago, que le monde entier n’a pas disparu sous les décombres. Bien au contraire, tandis que la côte Est des Etats-Unis est toujours à feu et à sang, les villes de la côte Ouest ont repris leur vie presque normalement, une fois passée une période de troubles provoqués par la panique. Nulle attaque sur San Francisco et Los Angeles, où Marc et Colin finissent par devenir célèbres en racontant l’histoire de leur périple à travers le continent. Nulle tentative non plus, de la part des décideurs de ce côté-là des Etats-Unis, pour secourir d’éventuels survivants à Boston, Philadelphie ou New-York.
Cette découverte qui intervient aux deux tiers du roman soulève évidemment de nombreuses questions, qui ne sont pas toutes élucidées. Le rebondissement déstabilise, pas seulement parce qu’il paraît scandaleusement inconcevable, mais aussi parce qu’il place au cœur de l’intrigue la question du mensonge, déjà présente, aux marges, dans la première partie du roman.
Mensonges gouvernementaux et mises en scène médiatiques sont ainsi entrevus par Marc et Colin qui sortent tout juste de l’enfer. Le rapport qu’ont à la catastrophe les habitants de la partie de l’Amérique épargnée est profondément marqué par les rumeurs, ni l’origine ni les conséquences du drame n’étant tout à fait claires à force d’être exploitées dans diverses entreprises de storytelling médiatiques qui déforment la réalité.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le récit de Marc et Colin, de leur périple à travers les ruines de l’Amérique. Aussitôt, parce qu’elle s’oppose au récit dominant, leur parole est mise en doute, accédant à son tour au statut de fiction. Ainsi, ensevelie sous ces multiples couches de récit, la réalité du cataclysme s’éloigne, s’estompe. Benjamin Hoffmann utilise avec brio ce dispositif paradoxal dans lequel il place ses héros pour aboutir à un final étrange et déroutant qui fait la critique de notre propre rapport aux récits médiatiques et de l’invasion du storytelling dans la réalité.
Publié le 13/04/2016 - CC BY-SA 3.0 FR

Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires