Appartient au dossier : Les visages du documentaire canadien
Les débuts du cinéma documentaire canadien
Le développement du documentaire au Canada est lié à celui des chemins de fer. Les premières vues canadiennes sont en effet financées par la Canadian Pacific Railway Company pour attirer de nouveaux habitants sur des terres colonisées accessibles par le rail. Le cinéma documentaire canadien se développe ensuite dans des directions parfois opposées, entre vues touristiques, effort de guerre, entreprises de colonisation et revendications identitaires, comme le montre le cycle « Au Canada… Traversée documentaire », proposé par la Cinémathèque du documentaire à la Bpi à l’automne 2022.
La première projection cinématographique publique au Canada a lieu le 27 juin 1896, six mois à peine après que les frères Lumière ont organisé la première séance de cinématographe au monde, à Paris. Cependant, le Canada souffre longtemps d’avoir pour voisin le premier pourvoyeur mondial de films, les États-Unis. En effet, de nombreuses salles appartiennent à des complexes américains qui y diffusent leurs films, beaucoup de réalisateurs partent travailler de l’autre côté de la frontière et la langue anglaise commune accentue encore la circulation à sens unique des films. En 1923, les productions canadiennes s’effondrent quand Hollywood met la main sur le marché de diffusion local. Les institutions canadiennes d’État de soutien au cinéma se développent dès lors, et soutiennent d’autres productions que la fiction classique, notamment le documentaire.
Des débuts promotionnels
Il faut attendre 1898 pour que soient projetés les premiers films canadiens, réalisés à l’automne 1897. Il s’agit de vues documentaires à but promotionnel – autrement dit, de la première publicité filmée au monde. James Freer, agriculteur, s’est équipé auprès de la société Edison pour filmer des terres agricoles et des chemins de fer dans le Manitoba. La Canadian Pacific Railway Company finance ses films dans le but d’encourager l’immigration au Manitoba, notamment auprès du public britannique, en vantant la richesse de terres considérées comme disponibles. Parmi ces vues, se trouvent Arrival of CPR Express at Winnipeg, Pacific and Atlantic Mail Trains et Six Binders at Work in a Hundred Acre Wheatfield.
La même année, la Canadian Pacific Railway Company engage une entreprise britannique pour bâtir une équipe de cinéastes, la Bioscope Company of Canada, afin de réaliser Living Canada. Cette série composée de 35 scènes illustre la vie au Canada, toujours pour inciter les citoyens britanniques à s’installer sur ses terres. La société de chemins de fer indique aux opérateurs de prises de vues d’éviter les vues de neige, pour ne pas décourager les candidats à l’immigration !
En 1918, le gouvernement canadien crée l’Exhibits and Publicity Bureau. Cette institution publique produit des films touristiques. En 1923, elle devient le Canadian Government Motion Picture Bureau ; en 1939, cet organisme prend le nom de National Film Board of Canada, ou Office national du film du Canada (ONF), qui deviendra une institution incontournable pour le cinéma canadien. Côté privé, la Canadian Pacific Railway Company rachète en 1921 une majorité des parts du studio américain Associated Screen News, établi à Montréal. Le studio devient la première infrastructure complète de production au Québec. L’Associated Screen News produit des films touristiques, qui vantent les mérites du chemin de fer et de la vie dans la nature pour le compte de son principal actionnaire. La société produit également des films industriels, des actualités et des films ethnographiques sur les peuples autochtones. Comme le remarque le producteur et réalisateur John Grierson, premier directeur de l’ONF :
« Si la vie au Canada avait ressemblé à ces films, les Canadiens auraient passé leur temps à pêcher, jouer au golf et observer la faune sauvage. Il n’y aurait eu aucune industrie, très peu de travail et aucun ouvrier. »
De son côté, l’Ontario Motion Picture Bureau (OMPB), premier organisme au monde parrainé par l’État, est fondé en mai 1917 pour proposer « des œuvres éducatives aux fermiers, aux écoliers, aux ouvriers et aux autres classes ». Son objectif est, là encore, de promouvoir l’Ontario et d’encourager les projets d’infrastructure. Dans les années vingt, l’OMPB distribue jusqu’à 1 500 bobines par mois. Il produit notamment des « drames documentaires » mêlant fiction et prises de vues documentaires, comme le long métrage Cinderella of the Farms, réalisé en 1931 par John McLean French. Puis, son système de distribution devient obsolète et l’organisme ferme en 1934. Il établit néanmoins les bases de l’implication des provinces dans la cinématographie canadienne, aux côtés des institutions de l’État central.
Le National Parks Bureau (Parcs Canada), quant à lui, coproduit notamment des films ayant pour sujet la préservation de la nature et l’aventure, comme les courts métrages autour du garde-forestier Archibald Belaney, dit Grey Owl, à partir de 1928. Le Peuple des castors (1928), de Bill Oliver, montre ainsi Grey Owl et son épouse Anahareo avec les deux castors (Mac Ginnis et Mac Ginty) qu’ils ont adoptés, apprivoisés et élevés après que leur mère fut tuée. Le P’tit Frère de Grey Owl (1932), réalisé par Gordon Sparling, exploite la même trame narrative. Ces films quittent ainsi le tracé des voies de chemin de fer pour montrer de manière plus directe la faune et la flore canadiennes.
Nouvelles du Canada
À partir de 1907, Léo-Ernest Ouimet, premier à avoir ouvert une salle de cinéma au Canada en 1906, commence à tourner des vues d’actualité. Il enregistre ainsi des images sensationnalistes du Désastre du Pont du Québec (1908), un accident durant lequel 75 ouvriers perdent la vie ; de l’Incendie de Trois-Rivières qui détruit 800 bâtiments en 1908 ; de la descente des Chutes du Niagara en tonneau par Bobby Leach (1911) ; des conséquences du naufrage de l’Empress of Ireland dans l’estuaire du Saint-Laurent qui fait 1 012 victimes en 1914 ; ou encore de l’explosion de Halifax, causée en 1917 par une collision entre deux navires dont un rempli de munitions, qui tue 2 000 personnes et en blesse des milliers d’autres. Ouimet n’hésite pas à reconstituer les événements lorsqu’il ne peut être sur place – proposant ainsi sa propre version d’un accident de train dans une gare de Montréal en 1909, ou du naufrage du Titanic en 1912. En 1907, il propose un usage novateur du montage, après avoir placé des caméras à plusieurs étapes d’une course à pied dans les rues de Montréal, ainsi que sur une voiture suivant les coureurs. En 1915, Ouimet crée la société Specialty Film Import. Par ce biais, il distribue ses séries d’actualités dans le réseau des salles canadiennes jusqu’en 1922.
Pendant la Première Guerre mondiale, d’autres séries d’actualités canadiennes voient le jour, comme Canada in Peace and War (Conness Till, 1915) et B. C. for the Empire (A. D. Kean, 1916). Après la guerre cependant, les séries d’actualités canadiennes sont réalisées par des filiales de sociétés de production américaines.
En 1931, le producteur Gordon Sparling est embauché par l’Associated Screen News. Sous son impulsion, la série documentaire Canadian Cameos débute un an plus tard. Elle durera jusqu’en 1954, date à laquelle elle compte 85 courts métrages traitant de différents aspects de la vie canadienne : le sport, l’histoire, plusieurs portraits… Sparling réalise notamment dans ce cadre Rhapsody in Two Languages (1934), une symphonie urbaine racontant une journée à Montréal, inspirée notamment de Berlin, symphonie d’une grande ville de Walter Ruttmann (1924). Après la Seconde Guerre mondiale, Sparling travaille à l’ONF. Il réalise plus de 200 films au cours de sa carrière. Jusque dans les années cinquante, l’Associated Screen News produit également les séries documentaires Kinogram Travelogues et Camera Rambles. La société met fin à ses activités en 1957, alors que s’amorce le virage du cinéma direct.
Premiers regards sur le quotidien
La répartition des salles sur l’immense territoire canadien est bien sûr inégale, notamment entre villes et campagnes. De ce fait, dans les années trente, des opérateurs amateurs tels que Alfred Booth en Colombie-Britannique, Albert Tessier dans la région de Trois-Rivières ou Maurice Proulx en Abitibi ont un rôle non négligeable dans la réalisation et la diffusion de vues documentaires. Projectionnistes itinérants eux-mêmes ou leur remettant leurs films, ils permettent de diffuser le cinéma dans des villages reculés, grâce aux associations éducatives et paroissiales.
Monseigneur Albert Tessier, par exemple, lui-même membre du clergé, montre dès 1925 le quotidien et tente d’en révéler la beauté, participant à la vie des communautés qu’il vient filmer, dans une démarche qui anticipe le cinéma direct. Ses films parlent de l’éducation des enfants en milieu rural – notamment celle des jeunes filles –, des travaux ménagers et de l’artisanat, de l’agriculture, de la nature, et des valeurs spirituelles qui prévalent dans ces territoires. Il tournera jusqu’en 1960, réalisant 70 films, et son rôle de précurseur du cinéma sera reconnu par la création en 1980 du Prix Albert-Tessier, plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable au cinéma québécois.
L’abbé Maurice Proulx filme lui aussi la ruralité comme un monde à part entière dès 1934, par exemple dans En pays neufs (1934-37), premier long métrage documentaire en français, ou En pays pittoresques (1938-39). Ses documentaires au ton didactique ressemblent en même temps à des albums de famille, promouvant le travail en coopérative, l’autosuffisance, l’importance des traditions et de la religion. Ses films permettent simultanément d’accompagner la colonisation de la Gaspésie et de l’Abitibi jusqu’en 1950 – l’Abitibi, située à 800 kilomètres au nord de Montréal, est en effet la dernière région à avoir été colonisée, dans les années trente.
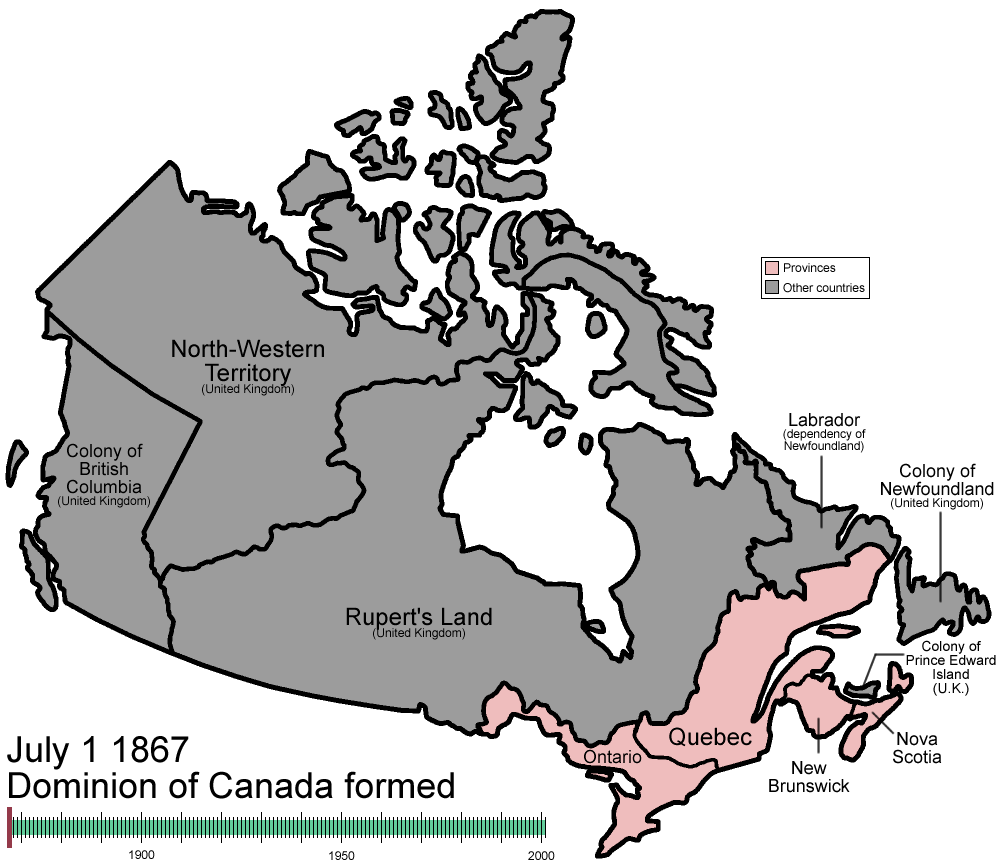
Golbez., CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Dans les années quarante, d’autres religieux tels que le frère Adrien Rivard ou Louis-Roger Lafleur tournent des films documentaires. Ce dernier, recruteur de missionnaires auprès des Amérindiens, est le premier cinéaste-ethnographe québécois et jette, dans ses films, un regard progressiste sur la culture autochtone. Des laïcs réalisent eux aussi des documentaires : Paul Provencher filme la vie en forêt et les autochtones, Herménégilde Lavoie tourne la série de douze courts métrages Les Beautés de mon pays. À l’ONF, Bernard Devlin et Raymond Garceau tentent quant à eux de conjuguer dans leurs films respectifs ville et campagne, tradition et modernité, suivant un point de vue plus progressiste.
Cependant, jusqu’à cette époque, le documentaire dans le pays se résume principalement à des vues touristiques et d’actualité, portant un discours univoque de défense des traditions et tentant de bâtir une identité culturelle canadienne. Il faudra attendre la fin des années cinquante pour qu’émerge véritablement un cinéma documentaire canadien, notamment par le biais du cinéma direct québécois, et la décennie suivante pour que les populations autochtones commencent à s’emparer, elles aussi, de ce moyen artistique d’expression et de revendication identitaire.
Publié le 29/08/2022 - CC BY-SA 4.0
Pour aller plus loin
L’histoire du film canadien : 1896 à 1938 | L'Encyclopédie canadienne, 2012
Cet article est l’un des quatre articles qui retracent l’histoire de l’industrie cinématographique au Canada. La série complète comprend :
Les Cinémas du Canada : Québec, Ontario, Prairies, côte Ouest, Atlantique
André Pâquet & Sylvain Garel (dir.)
Centre Georges Pompidou, 1992
Cette mine d’informations sur l’histoire des cinémas canadiens a été conçue à l’occasion de la rétrospective consacrée aux cinémas du Canada au Centre Pompidou de février à juin 1993. L’ouvrage collectif commence par une frise chronologique qui va de l’arrivée des Premières Nations sur le territoire en -35 000 jusqu’à 1992, s’arrêtant spécifiquement sur les événement liés à la société, à la culture en général, et au cinéma en particulier.
L’ouvrage analyse les spécificités du cinéma québécois mais aborde également l’histoire de celui des autres provinces canadiennes et certains enjeux particuliers du cinéma dans les territoires anglophones. Il évoque plus succinctement l’essor du film d’animation et des nouvelles technologies.
Enfin, des annexes très riches proposent entre autres un dictionnaire des réalisateurs québécois et un autre des réalisateurs canadiens, comportant une biographie et une filmographie pour chacun, ou encore un glossaire des termes clés pour comprendre mieux encore l’histoire culturelle des cinémas canadiens.
À la Bpi, niveau 3, 791(71) CIN
Canadian Film
David Clanfield
Oxford University Press, 1987
Cet ouvrage en anglais propose une vue d’ensemble de l’histoire du cinéma au Canada jusqu’aux années quatre-vingt. Un premier chapitre relate le développement de l’industrie cinématographique jusqu’en 1939. Les chapitres suivants traitent successivement de l’histoire depuis 1939 du documentaire anglophone, du documentaire francophone, de la fiction francophone, de la fiction anglophone, et du cinéma expérimental et d’animation.
David Clanfield, chercheur en littérature et en cinéma, spécialiste du cinéma documentaire, met l’accent sur la manière dont le cinéma a été utilisé pour encourager l’immigration, défendre les traditions et promouvoir une identité canadienne.
À la Bpi, niveau 3, 791(71) CLA
Histoire générale du cinéma au Québec
Yves Lever
Boréal, 1988
Yves Lever, spécialiste de l’histoire du cinéma, présente dans cet ouvrage une histoire chronologique du cinéma au Québec en quatre parties. Pensée de manière sociologique, cette histoire s’arrête, dans chaque partie, sur les enjeux liés à la production, à la distribution, à l’exploitation, à la législation et à la critique des films.
À la Bpi, niveau 3, 791(714) LEV
Cinéma / Canada
Marta Dvorak (dir.)
Presses universitaires de Rennes, 2000
Cet ouvrage propose une vision panoramique des cinémas canadiens des origines au début des années deux mille, à travers une succession d’articles rédigés par des spécialistes universitaires.
Le premier article, de Jean-Pierre Berthome, propose une histoire générale du cinéma canadien ; dans le deuxième article, Sylvain Garel se concentre sur le cinéma québécois ; le troisième article, de Dominique Noguez, analyse les enjeux du cinéma-vérité dans les années soixante ; Michel Coulombe revient ensuite sur le cinéma québécois dans les années quatre-vingt-dix ; Pascal Vimenet s’arrête sur le cinéma d’animation ; Simone Suchet se concentre sur les films anglophones depuis les années soixante ; puis, Marta Dvorak propose une analyse de films de quelques cinéastes anglophones contemporains.
La retranscription d’une table ronde constituée de professionnels du cinéma québécois clôt l’ouvrage.
À la Bpi, niveau 3, 791(71) CIN
Les champs signalés avec une étoile (*) sont obligatoires